
Écrivain jeunesse traduit dans le monde entier et dont le roman phare Tobie Lolness vient d’être adapté sur France TV, Timothée de Fombelle nous reçoit dans son atelier parisien, où il peaufine ces jours-ci le troisième et dernier tome de la saga Alma, à paraître au printemps 2024. Rencontre avec un artiste qui croit au pouvoir des récits que l’on transmet.
Quelle est la première histoire qui vous a marqué ?
Celle de mon grand-père, officier de cavalerie, fait prisonnier par les Allemands en juin 1940. Sur la route des vacances, je lui demandais de raconter encore et encore ses souvenirs de captivité. Ses tentatives d’évasion ont suffi à remplir mon enfance. Des années plus tard, quand mon premier roman a été publié, un critique y a vu « un grand récit d’évasion ». Mon grand-père n’était plus là, malheureusement. Mais j’avais le sentiment du devoir accompli. Ce thème de l’évasion traverse toutes mes histoires.
Vous avez toujours été un grand lecteur ?
Certains ouvrages m’ont profondément marqué, comme ceux de Tomi Ungerer, extraordinaire dessinateur et raconteur d’histoires alsacien. J’ai grandi avec ses albums. Les trois brigands, Le géant de Zéralda ou Jean de la lune ont tous été publiés avant 1973, l’année de ma naissance : c’est comme si ces livres m’attendaient. Les histoires répétées et relues finissent par tapisser notre mémoire et notre imaginaire.
Et il y a le théâtre !
Après avoir lu tant d’histoires et perçu leur pouvoir, j’ai voulu en raconter à mon tour. Je me souviens de l’été de mes huit ans. Torpeur d’un mois d’août sans fin. Avec mes cousins, nous décidons de monter une pièce de théâtre. Et tout d’un coup, ma cousine Violaine, me lance sur le ton de l’évidence : « A toi de jouer, c’est toi qui l’écris. » Voilà comment naît un destin d’écrivain, dans l’intimité familiale. Nos spectacles étaient imparfaits mais nous allions jusqu’au bout, grâce aux talents de chacun. Nous bricolions les décors et les costumes – un chapeau ou une robe piqués dans l’armoire de notre grand-mère ! -, démontant les projecteurs du salon pour éclairer la scène…
Après vos études de lettres, vous choisissez l’enseignement. Pourquoi ?
Pour ne pas m’éloigner des histoires et des livres. Sans doute cela a-t-il compté dans le fait que je reste connecté à l’enfance. Et sans doute cela a-t-il influencé ma trajectoire. Dans la banlieue où j’enseignais, la littérature pouvait sembler loin. Nous étions surtout éducateurs. Et tandis que j’écrivais le soir, mes collégiens me rappelaient combien la sortie de l’enfance est un moment délicat et essentiel.
Après avoir lu tant d’histoires et perçu leur pouvoir, j’ai voulu en raconter à mon tour.
Timothée de Fombelle
Comment avez-vous vécu le succès mondial de votre roman Tobie Lolness, qui raconte une formidable aventure dans un monde miniature logé au creux d’un arbre ?
Quand Tobie Lolness est sorti, en 2006, je me sentais déjà comme un vieil écrivain, aussi curieux que cela puisse paraître. Je n’avais que 30 ans mais j’écrivais depuis mon plus jeune âge. Pièces, discours de mariage, revue littéraire au lycée… J’avais l’illusion d’avoir du métier. Ça a été fou : très vite le roman a été traduit dans 25 pays. Le destin de ce livre m’émeut : il réunit désormais trois générations de lecteurs ; des très jeunes libraires me disent qu’ils ont découvert la lecture grâce à Tobie… Pourquoi ? C’est un mystère. Peut-être que j’ai abordé certaines thématiques juste avant qu’elles ne deviennent cruciales pour la société, comme la fragilité ou la protection de l’environnement.
Une série animée adaptée de ce roman doit être diffusée sur France Télévision. Quel destin pour votre héros !
C’est une aventure incroyable : 296 personnes dont 8 scénaristes ont travaillé sur cette adaptation, entre Annecy, Angoulême, Liège et Paris. Toutes ces personnes ont “avalé” mon histoire pour en faire leur propre création. Je ne peux qu’être heureux. C’est fidèle à l’âme de mon livre, tout étant plein d’innovation.
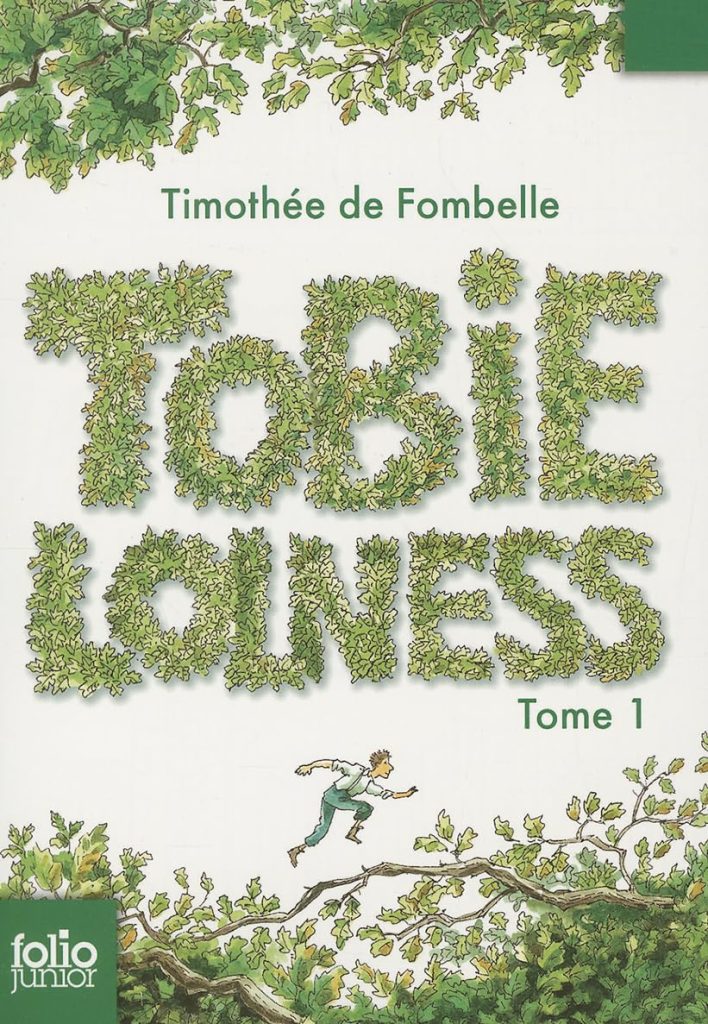
Et pourtant, vous êtes prudent sur tout le marketing et le merchandising liés à l’univers de votre roman. Vous êtes par exemple peu favorable à la vente de figurines, de produits dérivés… Craignez-vous de voir votre œuvre dénaturée ?
Je ne suis pas contre cette interpénétration, cette capillarité avec le réel, mais alors avec la vie, pas avec les objets. Quand une bande de sept jeunes lecteurs qui se sont connus sur les réseaux sociaux par l’intermédiaire de mon roman Vango, décident l’été de leurs 18 ans de partir dans les îles Éoliennes, lieu natal de mon héros… c’est pour moi le meilleur des produits dérivés : la fécondité dans la vie. La boutique où je vous reçois pour cette interview, et qui me sert d’atelier, a inspiré le restaurant La belle étoile dans Vango, mais aussi la boutique de guimauve dans le livre de Perle… je ne peux pas m’empêcher d’établir des liens avec le réel. Autour de Tobie, nous avons créé “les Amis de Tobie”, pour soutenir l’agroforesterie, en cohérence avec les valeurs qui irriguent ce livre.
Votre actualité, c’est aussi la traduction en anglais d’un très beau conte de Noël mettant en scène une hirondelle et un migrant (Quelqu’un m’attend derrière la neige / A swallow in winter) nominé pour un très prestigieux prix outre-Manche…
Ce conte, c’est ma première tentative de parler de notre époque. Dans mes livres, évidemment, je m’adresse au temps dans lequel je vis. Mais j’ai toujours besoin d’un détour : Tobie et sa petite humanité suspendue dans un arbre ; Vango et la première moitié du XXe siècle ; Le livre de Perle et son monde féérique ; Alma et la fin du XVIIIe siècle. Dans ce conte, j’assume d’être sans filtre. Je parle d’aujourd’hui. Peut-être parce que Noël, c’est le droit au miracle.

On vous range souvent dans la case « littérature jeunesse ». Cette affiliation n’est-elle pas réductrice ?
Je m’inscris dans la tradition de la littérature populaire d’Alexandre Dumas, Jules Verne ou Eugène Sue. Aujourd’hui, la littérature jeunesse est devenue pour moi un espace de liberté. Je peux écrire des romans fleuves dans des époques lointaines, réaliser des albums illustrés comme des livres d’art. Cela m’enlève le poids de la littérature avec un L majuscule. Mais dans littérature jeunesse, il y a littérature, ne l’oublions pas ! Lors du dernier salon de littérature jeunesse de Montreuil, un enfant sur deux me parlait de style : « Votre écriture me touche ». Ça prouve que la littérature jeunesse est une initiation à la lecture et une fabrique du lecteur. Et vous savez, les parents piquent les livres de leurs enfants ! La moitié de mes lecteurs sont des adultes.
Quel conseil donneriez-vous aux parents qui souhaitent que leurs enfants lisent davantage ?
Ne désespérez pas ! Il faut trouver la porte d’entrée, et donc trouver LE livre. Il faut avoir foi dans la littérature : si le jeune ne lit pas c’est que ce n’était pas le bon rendez-vous. Un livre, c’est une rencontre. En tant que parents, nous devons libérer le temps des enfants, tenter d’établir des règles pour l’usage des écrans. Il ne faut pas avoir peur de l’ennui. Il n’y en aura jamais trop dans notre société. Et c’est aussi le boulot de l’écrivain, qui doit s’efforcer de créer des histoires irrésistibles.
Pourquoi avons-nous tant besoin de récits ?
Nous avons besoin de nous arrêter sur la vie, de mettre une loupe dessus pour la voir plus grande. Lire et écrire, c’est l’art de s’éloigner du réel pour y revenir bien vite, et en parler. Je crois que nous avons besoin de récit aussi pour ne pas être seuls. Quand on lit Rimbaud ou Rilke à 17 ans, on touche du doigt l’universalité. Un récit, c’est un miroir qui permet de se faire peur ou d’espérer. La société a besoin de ça. J’observe d’ailleurs le retour du récit dans sa linéarité, en réaction à l’instantané de l’image. Il y a ce besoin de s’arrêter, de prendre du temps, ce que permet la lecture.
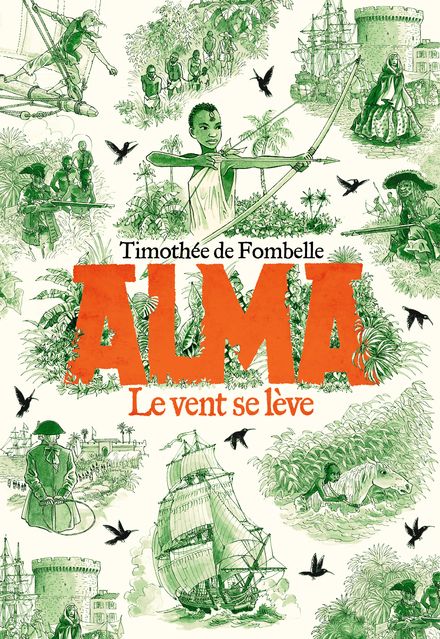
En 2020, la traduction du premier volet d’Alma, le vent se lève – une formidable histoire d’amour et d’aventure sur fond de traite négrière – a connu des remous dans le monde anglo-saxon, au motif qu’un auteur blanc ne peut pas écrire sur ce sujet. La liberté des créateurs est-elle en recul ?
Le risque existe. Mais le principal barrage, c’est l’auto-censure. La littérature est le lieu pour raconter d’autres vies que la nôtre, et cela n’a pas de limites. Comme écrivain, je veux pouvoir écrire sur ce qui me tient à cœur. Une catégorie de personnes refuse de lire ce livre à cause de mon identité et cela me désole.
Mais je trouve aussi cela stimulant. Cette supposée illégitimité m’a poussé à être irréprochable et à travailler cent fois plus. J’ai compulsé plus de 400 livres sur tous les sujets traités dans le roman : culture de la canne, du coton ou du café ; architecture navale d’un bateau négrier parti de Rochefort en 1786… A 13 ans, j’ai découvert sur les plages du Ghana les forts à l’abandon où étaient triés les esclaves. Le choc fut tel que je suis rentré chez moi et que je me suis mis à écrire cette histoire. Il m’a fallu 35 ans pour aller au bout. Ce livre, je ne pouvais pas ne pas l’écrire. Comme le dit si bien la poétesse noire-américaine Maya Angelou, que je cite en exergue du tome 3 d’Alma qui sort au printemps 2024 : « Il n’y a pas de plus grand chagrin que de garder une histoire non racontée à l’intérieur de soi ». Je veux être jugé sur mes livres, rien d’autre.
Quels sont, en ce moment, les livres ou les séries qui vous inspirent ?
Le Règne animal de Thomas Cailley m’a intéressé. J’ai apprécié ce fantastique un peu bricolé. J’aime quand le genre s’échappe de sa case : on est dans le fantastique, mais c’est aussi un film sur la sortie de l’enfance, avec ce personnage d’un adolescent en train de se transformer. Il pose une question qui rejoint celles qui m’habitent : à quel moment sort-on de l’enfance, et quelles en sont les frontières, les points de passage ? Récemment, la série irlandaise Normal People m’a aussi séduit. C’est le contraire de ce que je fais et cela me passionne : une histoire d’amour entre deux étudiants d’aujourd’hui, que l’on suit pendant quelques années. Il ne se passe absolument rien. J’admire cela car je n’en suis pas capable : j’ai besoin de mettre du charbon d’aventure pour pouvoir ensuite arrêter le lecteur et raconter la floraison du caféier en Sicile pendant deux pages ! Je vous recommande aussi la BD Révolution, de Florent Grouazel et Younn Locard chez Actes Sud, dont je viens de lire le premier tome, exceptionnel de richesse.
Une pub qui vous a marqué ?
Celle de l’entreprise Epuron en 2007, sur l’énergie éolienne. Cette pub magnifique met en scène le comédien français Guillaume Delaunay, qui mesure 2,06 mètres. On suit ce géant dans la rue. Musique mélancolique. Voix off. « Je crois que j’avais le sentiment toujours mal compris, on aurait dit que les gens ne m’aimaient pas. Je me sentais seul, vraiment seul. » Le personnage soulève une jupe, jette du sable sur une fillette, décoiffe une dame, renverse un pot de fleurs, fait claquer des volets… et puis on le voit dans le bureau d’un recruteur : « Un jour, tout a changé. Quelqu’un a fini par m’accepter tel que je suis. Depuis que j’ai décroché ce job, ma vie a complètement changé. » On comprend alors qu’il personnifie le vent. La fragilité se transforme en force et en talent. Efficace et si émouvant !
Quels sont, selon vous, les ingrédients d’une bonne histoire ?
Une bonne histoire doit nous frapper avec une part de familiarité, pour pouvoir nous emmener ailleurs. Pour Alma, par exemple, je m’appuie sur l’imaginaire des livres de pirates, comme L’île au trésor, avant d’introduire la problématique de la traite négrière. Autre enjeu essentiel, s’assurer de la cohérence de chaque fil dont est tissée l’histoire : l’amour, le fantastique, la comédie…
La meilleure façon de finir une histoire ?
Dans une forme d’apaisement et de léger déséquilibre, qui laisse le champ ouvert à d’autres possibles. Car j’en suis convaincu : les histoires nous inventent.
Recueilli par Charles de Beistegui et François-Xavier Maigre
Photo header : Ashish R. Mishra sur Unsplash
Crédit Photo : Chloe Vollmer-Lo-Gallimard