
Dans son dernier ouvrage, Anne de Guigné, journaliste au Figaro, explore un rapprochement audacieux : faire dialoguer la littérature et l’économie. De Balzac à Dickens, en passant par Zola, elle montre combien les romanciers ont su capter l’essence de l’économie… mieux que les économistes eux-mêmes !
Comment vous est venue cette idée, pour le moins contre-intuitive, de lier littérature et économie ?
Anne de Guigné : De mon expérience personnelle. L’économie me passionne, car elle nous propose une grille d’analyse du réel. Quant au regard des romanciers sur le monde, il m’habite depuis l’enfance. Et ma réflexion est née à l’intersection de ces deux passions. En économie, j’ai presqu’autant appris chez Balzac et Dickens que chez Friedman ou Keynes.
Iriez-vous jusqu’à proclamer la supériorité du roman sur le traité économique, notamment lorsqu’il s’agit de mesurer la complexité d’un choix humain ?
Les deux genres ne couvrent pas exactement le même domaine. Pour embrasser la complexité de la condition humaine, le roman apporte une finesse et une richesse incomparables. Il permet d’incarner les idées, d’insuffler de la vie dans les concepts. L’économie analyse nos choix en fonction des intérêts supposés qui les motivent. Mais derrière un comportement, il y a aussi une part de fantasme ou de rêve, et cette dimension demeure largement inexplorée par les économistes. C’est précisément là que les écrivains sont magistraux ; ils approfondissent cette tension entre les intérêts et les rêves, entre la raison et la passion. Tom Wolfe ou Cervantes, pour ne citer qu’eux, dépeignent des individus mus par des choix parfois irrationnels, ce qui contredit la notion d’Homo Economicus. Paradoxalement, c’est bien la fiction qui ramène l’économie dans l’épaisseur de la condition humaine
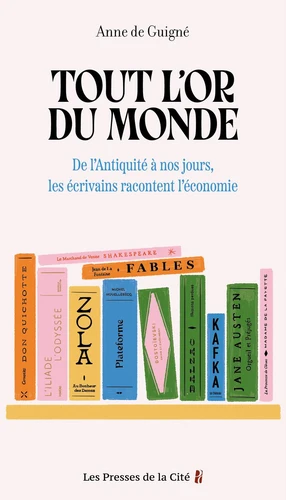
Comment les romanciers abordent-ils les grandes idéologies économiques ?
Ils critiquent volontiers le capitalisme et le libéralisme. Leur rôle est de mettre en lumière les limites et les failles des systèmes, et de nous alerter, tels des vigies. Ces observateurs ont souvent un regard conservateur face à l’innovation, soucieux de préserver la condition humaine. Ils estiment de leur responsabilité de perpétuer une certaine manière d’habiter le monde. Relire Dostoïevski, par exemple, nous met face une critique radicale de la prétention socialiste (éteindre la liberté) et de la prétention libérale (mettre tout le monde au travail pour augmenter le PIB).
La littérature peut-elle changer la réalité économique ou sociale ?
Certains écrivains ont clairement bousculé leur époque. En Grande-Bretagne, Charles Dickens en est l’exemple le plus éloquent : chacun de ses romans était suivi de lois sociales. Il a fait découvrir aux parlementaires et à la haute bourgeoisie la réalité des conditions de travail en usine. En France, Germinal d’Emile Zola creuse une veine similaire, même si l’impact social fut sans doute moindre. C’est la force du récit : la littérature amène les lecteurs à penser contre eux-mêmes, ce qui peut sembler à contre-courant aujourd’hui, à l’heure des algorithmes et des bulles de filtre. Les histoires peuvent confronter des opinions qui, dans le champ politique, seraient irréconciliables.
Balzac lui-même fut tourmenté par l’argent ; il a lutté contre les créanciers, ce qui a sans doute aiguisé sa sensibilité sur le sujet. Zola, lui, propose une approche plus distante et intellectuelle.
Anne de Guigné Tweet
Si vous deviez retenir un romancier particulièrement affûté en matière économique, lequel serait-ce ?
Balzac est l’un des plus impressionnants. Il décrit très bien le mécanisme de l’intérêt, montre comment il fonctionne et comment il peut mener à des succès foudroyants. Il met également en lumière la fragilité humaine face au vertige de l’accumulation. Balzac lui-même fut tourmenté par l’argent ; il a lutté contre les créanciers, ce qui a sans doute aiguisé sa sensibilité sur le sujet. Zola, lui, propose une approche plus distante et intellectuelle. Il menait des enquêtes fouillées (comme pour Germinal, où il est même descendu dans les mines), mais il écrivait ensuite avec un pas de recul, contrairement à Balzac qui était “dedans”.
En économie, la grande question aujourd’hui, c’est celle de la répartition des richesses…
Rien de neuf sous le soleil ! Il est très frappant de constater que la structure de détention des richesses aux États-Unis aujourd’hui est la même que celle de Rome à l’époque de Néron (selon les historiens Walter Scheidel et Steven Friesen). Cela remet en question la réalité du progrès social sur le long terme. Entre 1100 et 1300, 20 % du surplus économique était consacré à la construction d’édifices religieux. Aujourd’hui, les hypermarchés ont remplacé les cathédrales. Notre surplus est largement capté par la consommation. Enfin, pour être précise, en France, notre surplus est financé par la dette… principalement pour payer des produits d’importation, ainsi que les dépenses de santé ou de dépendance.
Si les dirigeants d’entreprise devaient s’inspirer de vos travaux, quel roman leur recommanderiez-vous ?
Les Buddenbrooks de Thomas Mann. Ce roman dépeint avec une grande finesse les qualités humaines nécessaires pour réussir en affaires, en posant des questions morales puissantes au lecteur. Comment concilier sens du business et sensibilité artistique? L’histoire montre comment une lignée de commerçants s’étiole à mesure que les descendants se préoccupent de musique. La thèse de Thomas Mann ? Plus les dirigeants doutent de la finalité de leur activité, plus leur entreprise périclite. Ce roman s’interroge aussi sur la déconnexion : au-delà d’un certain seuil, la richesse altère-t-elle notre perception du monde ? La réponse est forcément nuancée. Une nuance que seule permet la littérature.
Recueilli par Pierre de Feydeau et François-Xavier Maigre