Radicalisation des convictions, défiance généralisée, incapacité à dialoguer… Jour après jour, No Com analyse la polarisation qui touche la société française.
Rencontre avec Laurence de Nervaux, directrice générale du think tank Destin Commun. Elle estime que ce phénomène, bien réel, doit être nuancé. Et surtout, qu’il n’a rien d’insurmontable.

La polarisation s’est imposée dans le vocabulaire de beaucoup d’analystes, comme le phénomène structurant de l’opinion aujourd’hui…
Pourquoi contestez-vous la pertinence de ce concept ?
Chez Destin Commun, c’est vrai que nous nuançons l’idée d’une « déferlante » de la polarisation.
Enquêtes qualitatives et quantitatives à l’appui, nous avons montré qu’autour d’épisodes clivants, le récit médiatique dominant est en décalage avec la réalité. Particulièrement au cours des émeutes de l’été 2023 : 75% des Français disaient qu’on peut déplorer la mort d’un jeune et aussi considérer que la police assume une mission difficile. On peut être inquiet de l’hostilité à l’égard des forces de l’ordre et dans le même temps réprouver celle à l’égard des jeunes des banlieues. De la même manière, sur le conflit au Proche-Orient, 70% des Français prennent acte de la complexité du conflit : à la fois horrifiés des attaques du 7 octobre et préoccupés par le sort des populations de Gaza.
Comment expliquez-vous le décalage entre ces chiffres et le ressenti de beaucoup de citoyens qui, au quotidien, ont le sentiment de vivre dans une nation de plus en plus fragmentée ?
C’est tout le paradoxe français ! Le ressenti de polarisation est très élevé. Une majorité de Français soutient désormais que nos différences sont trop importantes pour continuer d’avancer ensemble. Les chaînes d’info en continu décuplent ce phénomène, de même que les réseaux sociaux. Sur ces plateformes, la polarisation procède de deux circonstances concomitantes : le fait d’être dans une bulle (c’est-à-dire un groupe de supporters homogènes) et, en même temps, le fait d’entendre le groupe en face crier, ce qui donne envie de crier plus fort que les autres. Depuis sa reprise par Elon Musk, X est par exemple devenu un stade où nous risquons tous de devenir des hooligans.
Nous nuançons l’idée d’une « déferlante » de la polarisation. Enquêtes qualitatives et quantitatives à l’appui, nous avons montré qu’autour d’épisodes clivants, le récit médiatique dominant est en décalage avec la réalité.
Laurence de Nervaux Tweet
En France, ce climat n’est-il pas aussi le fruit de l’affaiblissement des espaces traditionnels de rencontre et d’expérience commune ?
L’Église, l’école ou encore l’armée ont été remplacées par d’autres lieux, parfois inattendus. Une dame interrogée nous a, par exemple, longuement parlé de son fan-club de teckels. Cela pourrait prêter à sourire, mais cela représente en réalité une énorme communauté, où se vit une expérience humaine et sociale positive qui va bien au-delà de la passion pour les chiens. Nous avons tous des occasions de nous rencontrer via des groupes d’affinités, pas forcément identitaires, dans la vie comme sur le Web. Le problème, c’est l’opacité des algorithmes qui favorise les contenus haineux, violents. Ce processus est toxique. Mais j’observe une vraie lueur d’espoir : l’aspiration à davantage de régulation des réseaux sociaux, qui suscite un consensus de plus en plus manifeste. 75% des Français sont pour leur interdiction aux moins de 15 ans.
Notre perception de la polarisation n’est-elle pas la conséquence d’une forme de « radicalisation de l’indifférence », avec un ventre mou passif qui laisse le champ libre à des groupes minoritaires, radicaux et bruyants ?
Votre observation rejoint le schéma du chercheur Bart Brandsma (1), qui distingue cinq rôles dans la polarisation : les pushers (les boutefeux), les joiners (les suiveurs), la silent majority (le milieu ambivalent), les bridge builders (les rassembleurs) et les scapegoats (les bouc-émissaires). Nos collègues de More in Common USA parlent même d’exhausted majority. Cette fatigue sociétale peut se muer en indifférence, teintée d’impuissance. S’exprime une exaspération, une lassitude d’un débat public beaucoup trop agressif, tendu. Brandsma estime que l’erreur des bridge builders est de vouloir à tout prix faire dialoguer les extrêmes. Ça ne marche pas, c’est trop frontal. C’est sur la silent majority qu’il faut travailler, pour lui redonner du pouvoir d’agir, la réengager dans le débat, dans la vie de la société, dans l’interaction avec les autres.
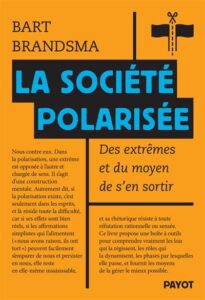
Comment expliquez-vous que l’écologie, qui devrait susciter l’adhésion de tous, soit aujourd’hui l’un des principaux carburants de la polarisation ?
De fait, la question de l’écologie, un des rares sujets qui avait le potentiel pour devenir une matrice de rassemblement, est aujourd’hui un sujet clivant. D’un côté, il a été capté par l’extrême droite pour en faire un réceptacle des frustrations, des colères, des ressentiments sans proposer de solution concrète. De l’autre, une partie de la gauche polarise l’écologie à coup de polémiques sur le barbecue, le sapin de Noël, et le Tour de France. Alors que pour les Français, l’écologie ce n’est pas une passion négative, c’est au contraire une volonté de préserver et de conserver un cadre de vie auquel ils sont attachés : une nature belle, des enfants en bonne santé, un air respirable, des rivières propres… Sur l’écologie, on devrait partir de là où les gens sont, plutôt que là où on voudrait les emmener.
Que peut faire l’entreprise ?
L’entreprise peut être une petite France qui nous rassemble, un des rares lieux où on est amené à rencontrer des personnes différentes de soi et où l’on n’a pas d’autre choix que de trouver des solutions et des terrains d’entente pour avancer ensemble. Elle permet de sortir de nos bulles, de proposer des univers qui ne nous sont pas familiers. Les entreprises sont le réceptacle de ce qui passe dans notre société, ni plus exemplaires, ni moins protégées. Elles peuvent être des témoins de diversité, de dialogue, et d’expérimentation de modes d’actions concrets et passionnés.
Quels sont selon vous les remèdes à la polarisation de la société ?
Pour nous, recréer un « destin commun » repose sur trois exigences. D’abord reprendre le contrôle sur les réseaux sociaux. Comme nous l’avons vu, c’est le souhait très majoritaire de l’opinion. Et cela tombe bien : des solutions techniques crédibles existent. Ensuite, il faut réinvestir les symboles républicains, et notamment revaloriser le drapeau tricolore, au-delà des seuls événements sportifs (une idée qui est consensuelle dans l’opinion, et même soutenue à 68% chez LFI). Il est regrettable de n’avoir à faire à Marianne qu’au moment des impôts ou en recevant une amende ! Et le plus fondamental de tout, dans un monde de plus en plus dominé par l’Intelligence Artificielle, les Français, dans nos enquêtes, aspirent à retrouver la part humaine des relations. Sans laquelle il n’y a pas de société.
Recueilli par Pierre de Feydeau et François-Xavier Maigre