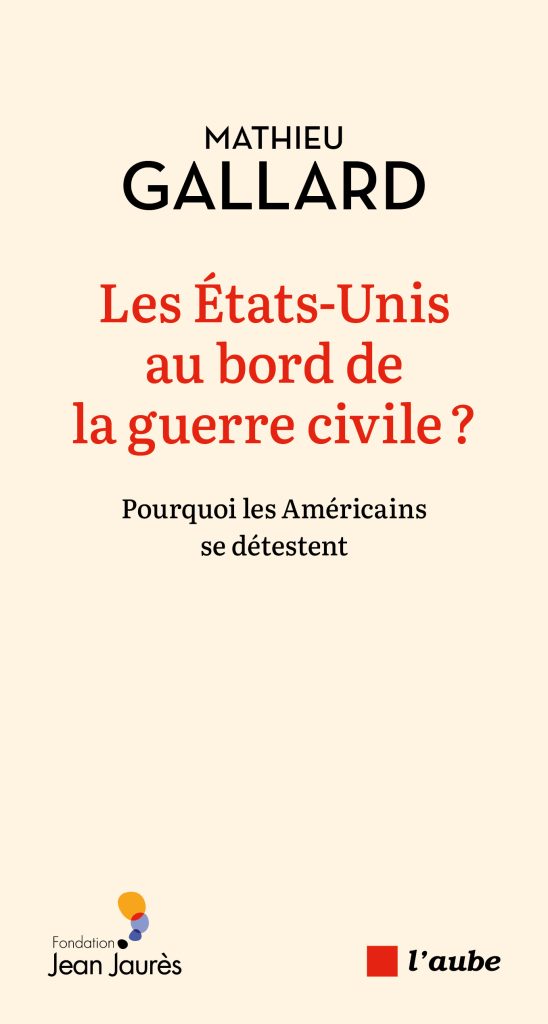
Dans un ouvrage au titre inquiétant (Les États-Unis au bord de la guerre civile ?, éd. L’Aube), Mathieu Gallard, directeur d’études chez Ipsos, décrypte la polarisation sans précédent de la société américaine. Tandis que partis et idéologies se radicalisent, le pays se divise, laissant place à des tensions et des opinions irréconciliables. Une situation irréversible ?
Femmes et hommes, métropolitains et ruraux, afro-américains et blancs, classes aisées et classes moyennes… L’électorat de Kamala Harris et de Donald Trump dessineune Amérique coupée en deux.
Dans un pays marqué par une guerre civile dont les blessures sont encore ouvertes, qui s’est déchiré sur la question de la ségrégation, la polarisation est un phénomène ancien. Mais son retour et son explosion sont récents, comme le démontre Mathieu Gallard dans son essai Les Etats-Unis au bord de la guerre civile ? (éd. l’Aube).
Études à l’appui, il révèle que les Etats-Unis, de l’après Guerre au début des années 1990, étaient marqués par une marginalisation de l’idéologie en politique. En 1956, lors du scrutin qui opposa le Président républicain sortant Dwight D. Eisenhower au démocrate Adlai Stevenson, seuls 12% des électeurs pouvaient être qualifiés « d’idéologues ». Le reste de l’électorat peinait à justifier son vote.
L’essor de la polarisation idéologique
L’explication ? Républicains et Démocrates étaient eux-mêmes des coalitions d’intérêts hétéroclites. Le noyau dur de l’électorat démocrate résidait dans les anciens États confédérés conservateurs. Le souvenir du Républicain Abraham Lincoln, figure de proue du Nord, les rebutait. À l’inverse, le démocrate Andrew Johnson avait œuvré pour leur réintégration dans la nation sans donner de garantie pour les droits civiques des esclaves affranchis. Ces démocrates du Sud venaient s’agréger à un électorat immigré, urbain, catholique, ouvrier et même afro-américain. De semblables disparités sociologiques se retrouvaient chez les Républicains. Résultat : au Congrès, les votes dépassaient souvent les lignes de fractures partisanes. En 1957, 167 Républicains votent pour (19 contre) le civil right act, visant à mieux protéger le droit de vote des Afro-Américains, alors qu’il est voté par 119 démocrates et rejeté par 107 d’entre eux. Le consensus est monnaie courante au Congrès, comme dans la société.
Seuls 9% des couples mariés sont composés de deux personnes d’un parti différent. Pire, on assiste à une explosion des crimes de haine, ciblant des personnes en fonction de leur identité supposée (politique, ethnique…), multipliés par deux entre 2011 et 2019.
Dans les années 1960, sous l’impulsion de Kennedy et de Johnson, le parti démocrate devient plus progressiste. Les Républicains décident d’en tirer bénéfice avec la « Southern Strategy », consistant à conquérir l’électorat blanc du « deep South » qui se sent trahi par les démocrates. Convictions idéologiques et vote commencent à se coordonner. Ainsi, dès 1968, 26% des électeurs sont « idéologues ». 14 points de plus qu’en 1956 !
Mais ce mouvement reste lent. Les Républicains disposent d’une structure militante embryonnaire dans le Sud, face à des Démocrates solidement ancrés. Si Reagan y triomphe aux présidentielles, les démocrates conservent leurs positions au Congrès, où règne l’art du compromis.
Bill Clinton, gouverneur de l’Arkansas, ancien état confédéré, démocrate élu président en 1992, est la dernière incarnation de cette époque. La vraie rupture date de son mandat. Durant les midterms de 1994, les Républicains y obtiennent une majorité dans le Sud pour la première fois de l’histoire. Dès lors, les votes des électeurs s’alignent très vite entre scrutin présidentiel et législatif, et, surtout avec leurs convictions idéologiques. En 2022, 220 démocrates votent pour l’Inflation Reduction Act de Biden, 0 contre, 207 Républicains contre, et 0 pour. La modération ne paye plus.
Cette idéologisation des élus se retrouve dans la société. Ce que Mathieu Gallard nomme « la polarisation affective ». En 1980, 48% des démocrates avaient une opinion favorable des républicains, 18% en 2020. En 2022, 83% des démocrates jugent les Républicains « intolérants » et 64% « malhonnêtes » (+13 et + 22 points depuis 2016), 72% des Républicains les jugent « amoraux » et 62% « feignants » (+25 et +16).
Et cela se traduit dans des choix de vie. Seuls 9% des couples mariés sont composés de deux personnes d’un parti différent. Pire, on assiste à une explosion des crimes de haine, ciblant des personnes en fonction de leur identité supposée (politique, ethnique…), multipliés par deux entre 2011 et 2019.
Est-ce à dire que la polarisation est un fléau en soi ? Non ! En 1950, l’American Political Science Association regrettait le trop faible niveau de polarisation des partis. Source de désintérêt pour la politique, d’arrangements entre élus, de difficultés pour les citoyens de motiver leurs choix. A contrario, une bonne dose de polarisation est saine : elle dope la participation et l’engagement. Comme le cholestérol, le problème réside donc dans son excès. Quand elle pousse à la détestation, au manichéisme voire à la guerre civile, dont le spectre hante commentateurs et scénaristes.
Un phénomène parti pour durer ?
La polarisation en croissance depuis 30 ans a-t-elle atteint son paroxysme ? Pas encore, répond Mathieu Gallard. Pour lui, les Afro-Américains et les Hispaniques, sont idéologiquement plutôt conservateurs, mais électoralement plutôt progressistes. S’ils alignaient vote et conviction, cela risquerait d’accroître encore la polarisation américaine entre “progressistes” et “conservateurs”. Un phénomène sans doute en germe puisque Donald Trump a considérablement progressé sur ces deux segments de population. L’antagonisation a de l’avenir !
À terme, pourtant, Mathieu Gallard parie que les excès de la polarisation finiront par lasser. L’histoire américaine va d’oscillation en oscillation, sur des cycles longs d’environ 40 ans. Comme l’apolitisme des années 1950 a succédé à de conflictuelles “Roaring Twenties” (les Années folles) la polarisation sera sans doute corrigée par une ère de réconciliation.
En attendant, la radicalisation des opinions devrait encore s’accentuer dans les années qui viennent aux Etats-Unis, comme en Europe, qui a souvent un temps de retard sur l’ouest de l’Atlantique. Et tester la résilience des sociétés comme des entreprises, souvent tentées de descendre dans l’arène de la polarisation, au risque de fragiliser leur corps social interne, et de perdre des clients.
Pierre de Feydeau
Les États-Unis au bord de la guerre civile ?, Mathieu Gallard, éd. l’aube, 104 p., 12 €